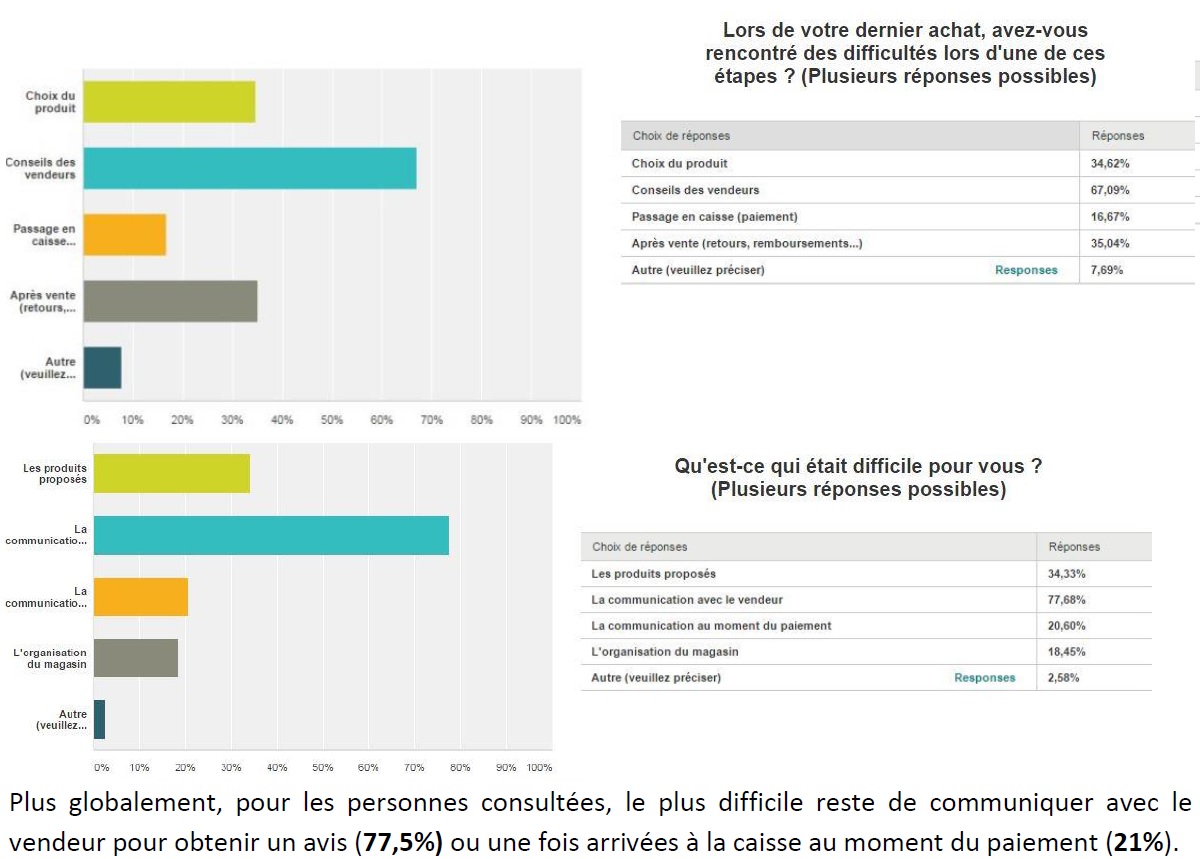Seule une personne sur quatre ayant une déficience auditive s'équipe d'une audioprothèse et 2,1 millions de personnes y renoncent pour des raisons financières, cette dépense pouvant représenter plus de 2000 € après remboursements, selon une étude publiée lundi par UFC-Que Choisir.
Avec une population de plus en plus vieillissante, les ventes d'audioprothèses ont plus que doublé depuis 2000, pour frôler les 600 000 en 2014, soit un marché de 927 M€, estime cette étude.
Mais sur les six millions de personnes souffrant de déficiences auditives pouvant justifier d'être appareillées, seules un quart (1,5 million) le sont. Car des freins demeurent, qui sont d'abord d'ordre financier. Le prix moyen d'un appareil auditif est en effet de 1550 € par oreille et dans 80% des cas, les acheteurs ont besoin d'équiper les deux oreilles, soit une dépense de 3100 €.
2,1 millions de personnes renoncentn à s'équiper d'un appareil auditif
Compte tenu des remboursements très limités de l'assurance-maladie et des mutuelles, les consommateurs conservent une dépense à leur charge de 1100 € par oreille (2200 € pour les deux). L'étude estime que 2,1 millions de personnes renoncent à s'équiper en raison du prix, au risque de s'isoler progressivement de leur entourage et de leur vie sociale. D'autres sont rebutées par des doutes sur l'efficacité de l'appareil ou ont encore des réticences psychologiques à porter une audioprothèse.
Les auteurs attribuent les prix dissuasifs à une « pénurie savamment entretenue d'audioprothésistes en France: ils sont environ 3100, pour des besoins estimés à 7150 professionnels, et sont donc en position d'obtenir auprès des enseignes des salaires élevés, qui se répercutent dans les prix.
Les appareils sont revendus "4,5 fois leur prix d'achat", soit une marge brute moyenne de 78%. Une fois les divers frais et salaires déduits, la marge nette se situe entre 15 et 18%, niveau supérieur au "déjà rentable secteur de l'optique".
Alain BAZOT : « La priorité est d'assainir ce marché, pour mettre fin à ce scandale sanitaire en France »
« La priorité est d'assainir ce marché, pour mettre fin à ce scandale sanitaire en France », estime le président d'UFC-Que Choisir, Alain BAZOT.
Pour enrayer la pénurie d'audioprothésistes et enclencher un "cercle vertueux qui ferait baisser les prix, l'association demande aux ministères de la Santé et de l'Education un relèvement du numerus clausus introduit à la rentrée 2015 (seuls 199 nouveaux professionnels seront formés cette année).
Le syndicat des audioprothèsiste s'indigne contre cette étude
Le syndicat national des audioprothésistes Unsaf, qui juge cette étude biaisée, avec des données incomplètes ou erronées, suggère plutôt d'améliorer le remboursement des appareils auditifs, dont les tarifs pour adultes n'ont pas été revus depuis 1986.
Autre motif qui fait grimper la facture, selon Que Choisir: le prix à régler par le consommateur inclut l'appareil lui-même et des prestations indissociables, les réglages initiaux et le suivi pendant la durée de vie du produit (cinq ans).
Cela revient à payer d'avance une prestation qui ne sera parfois pas utilisée, en cas de cessation de l'activité de l'audioprothésiste, d'arrêt du port de l'appareil ou de décès de l'acheteur. La loi Macron a supprimé le caractère indissociable de l'appareillage et du suivi, mais l'Assurance maladie doit encore adapter son processus de remboursement qui, aujourd'hui, continue à lier les deux.
L'étude dénonce les obscurs liens entre les audioprothésistes et les médecins ORL
L'étude dénonce par ailleurs les obscurs liens d'argent entre les audioprothésistes et les médecins ORL d'une part, les fabricants d'autre part. Elle estime que 30% des acheteurs se font conseiller par leur oto-rhino-laryngologiste (ORL) pour choisir un audioprothésiste. Or, ces derniers font bénéficier les médecins d'avantages en nature (repas, hébergement, voyages pour assister à des congrès ...) qui peuvent "laisser planer le doute" sur l'objectivité des ORL.
Les fabricants de leur côté détiennent souvent des parts dans le capital des audioprothésistes et peuvent même leur accorder des prêts. "La contrepartie est claire: mettre en avant leurs produits" plutôt que d'autres marques, juge l'association, réclamant une totale transparence sur ces liens.
La Rédaction / Avec AFP
 À la veille de journée mondiale d'Alzheimer qui a lieu le 21 septembre prochain, et de la Semaine de la Mémoire organisée à Bordeaux et sa région du 19 au 25 septembre (voir agenda). L’institut IFOP et l’Observatoire BV2 des mémoires viennent de publier une étude portant sur « Les Français et la prévention de la maladie d'Alzheimer » et l’état de connaissance du grand public sur le sujet. Un sujet de société quand ont sait que 900 000 personnes sont atteintes par la maladie en France et chaque année 225 000 nouveaux cas sont recensés.
À la veille de journée mondiale d'Alzheimer qui a lieu le 21 septembre prochain, et de la Semaine de la Mémoire organisée à Bordeaux et sa région du 19 au 25 septembre (voir agenda). L’institut IFOP et l’Observatoire BV2 des mémoires viennent de publier une étude portant sur « Les Français et la prévention de la maladie d'Alzheimer » et l’état de connaissance du grand public sur le sujet. Un sujet de société quand ont sait que 900 000 personnes sont atteintes par la maladie en France et chaque année 225 000 nouveaux cas sont recensés.